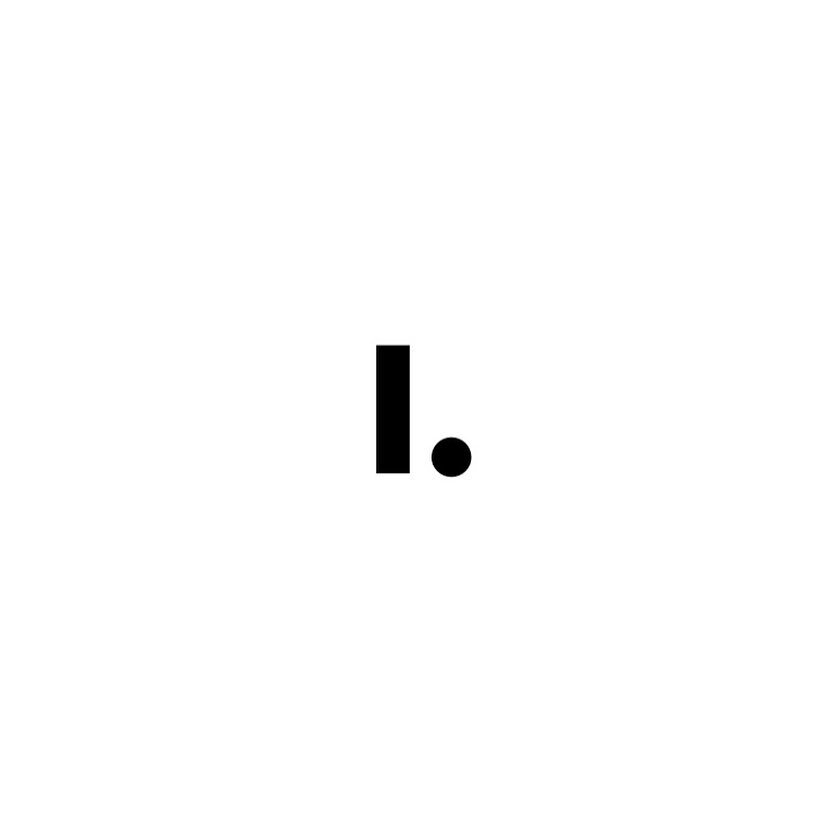“il faut lier le capital culturel avec le capital économique pour être révolutionnaire” - MILO RAU
La production de "Lénine" à la Schaubühne de Berlin © Thomas Aurin
La sphère politique a changé massivement depuis le début de la pandémie. En même temps, les praticiens de la culture ont également dû s'adapter à une nouvelle réalité. Béton Bleu a parlé avec Milo Rau, metteur en scène, cinéaste et militant, sur le rôle de l'art comme moyen de résistance et sur la manière dont il changera après la pandémie.
milo Rau © bea borgers
Béton Bleu : Milo Rau, la mise-en-scène, vous manque-t-elle ? Ou la pandémie vous a-t-elle incité à réaliser votre travail au-delà de la scène ?
Milo Rau : Je pense que d'une part les crises renforcent toujours le système, bien sûr, mais d'autre part elles ouvrent aussi de nouvelles voies. Vous avez beaucoup de choses dans le monde artistique qui ne peuvent être faites qu'en direct et ensemble. Notre société de production, comme le IIPM [International Institute of Political Murder] a rapidement des problèmes si elle ne peut plus jouer sur scène. À Gand, j’ai quand même tout essayé pour rémunérer les gens engagés ou au moins de leur trouver d’autres engagements pour réduire leur baisse de revenu. En même temps, c'est peut-être aussi une bonne chose que cette envie de retourner dans les salles du XIXe siècle soit en suspens depuis des mois. Parce-que la pandémie nous force aussi de trouver d'autres moyens.
BB : Avez-vous un exemple de ces autres moyens ?
MR : Pour la première fois, j'ai pu montrer mes œuvres comme "Lénine" ou le Tribunal du Congo à un public international, pour la première fois, ceux qui étaient concernés y ont eu accès : les Russes et les Congolais. Les prêteurs n'auraient jamais été prêts à le faire auparavant. En même temps, nous avons commencé à montrer nos performances à l'extérieur. Avec le festival "Tous les Grecs", nous jouons toutes les tragédies grecques en plein air pendant un mois, 32 pièces, toujours de 7 à 9h ou 8 à 10h du matin. Pourquoi toujours jouer le soir avec une lumière artificielle ? Pourquoi toujours commencer par le travail et puis l'art ? Pourquoi ne pas tout inverser ? Ce sont des choses qui semblent évidentes, mais auxquelles on ne pense pas à moins d'y être forcé. Mais j'ai un peu peur que la culture du théâtre et des débats de l'après-crise soit plus conservatrice qu'avant, car les gens auront toujours plus envie d'hyper-normalité.
BB : Lors de la pandémie, l'art a quitté son rôle souvent observateur et a été lui-même très directement touché. Dans de nombreux pays, dont l'Allemagne, les industries culturelles sont à l'arrêt. En France, nous voyons les travailleurs de l'industrie culturelle se battre et exiger un plus grand soutien de l'État. La culture est une partie très directe de la culture de protestation autour de la pandémie. Comment percevez-vous ce changement ?
MR : Le théâtre a besoin d'une présentation publique, cela a toujours été l'essence du théâtre. C'est différent avec le cinéma. Les cinémas sont fermés, mais on peut tout regarder en streaming - pour le "New Gospel", par exemple, nous avons construit nous-mêmes une plate-forme, avec 150 cinémas fermés réunis. Pour le théâtre, l'espace public et la participation sont essentiels. En même temps, je trouve les occupations de théâtre à presque un peu décevante. Pourquoi les gens veulent-ils retourner dans les mêmes salles de théâtre qu‘avant ? Pourquoi n'essayons-nous pas d'utiliser et de développer au mieux les possibilités dont nous disposons actuellement ? Il ne faut pas occuper les institutions pour y jouer, mais pour les obliger à démocratiser leurs moyens et leurs possibilités. C'est un peu comme avec les partis politiques : à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas aussi efficaces qu'on l'espérait et qu'il faut des mouvements extra-parlementaires pour changer vraiment quelque chose; il faut trouver des voies parallèles aux voies normales du capital. Et c'est là que l'obligation d'innover devient soudainement libératrice, en imposant des alternatives post-capitalistes.
Une scène du nouveau film de Milo Rau, "The New Gospel" © Fruitmarket:Langfilm
BB : Qu'entendez-vous par là précisément ?
MR : Au début de la pandémie, j'ai conçu une affiche pour le « Kammerspiele » qui disait : « Si vous n'êtes pas indispensable pour le système, alors peut-être que le système n'est pas indispensable pour vous. » Ce désir du secteur culturel d'être pertinent pour le système au sein du système capitaliste, en tant que partie de l'industrie du divertissement, est une mauvaise approche. Il est probablement préférable de créer des économies parallèles. Avec mon nouveau film, The New Gospel, nous avons également envisagé d'aller sur Netflix ou Amazon. Mais finalement, nous avons décidé de construire notre propre plateforme et nous avons obtenu les meilleurs résultats au box-office que j'aie jamais eus, en solidarité avec les cinémas fermés qui reçoivent les recettes. Vous n'êtes pas obligé de raconter les mêmes histoires dans les mêmes pièces avec les mêmes acteurs.
BB : Dans le manifeste de votre théâtre NT Gent vous avez écrit : " It's not just about portraying the world anymore. It's about changing it." Votre travail a porté sur le génocide au Rwanda et le déplacement des populations indigènes au Brésil. Votre dernier film, "The New Gospel", a été tourné en Italie avec des réfugiés. Comment amener les gens à ne pas se contenter de juste « consommer » de l'art mais de s’y engager ?
MR : Par coïncidence, je lisais une biographie de Beuys, qui l’a démontré, mais d'une manière parfois étrange. Il faut combiner l'art et le capital d'une manière révolutionnaire.Vous devez alors "hacker" le capitalisme, l'économie. L'art et l'engagement ne peuvent fonctionner indépendamment du capital, ils sont alors impuissants. Ce n’est pas la portée politique ou le pouvoir politique qui compte. L’art devient revolutionnaire lorsque l’on parvient à relier le système économique et culturel.
BB : Comment ?
MR : Quand nous avons tourné "The New Gospel" dans les camps de réfugiés du sud de l'Italie, nous avons dit : tous ceux qui jouent sur scène auront des papiers après. Et pour rendre cela durable, nous avons commencé à relier les canaux de distribution du film à ceux des marchandises, en l'occurrence des tomates. Soudain, il ne s'agit plus d'un film ou d'une politique de l'image, ce ne sont plus des conditions de production équitables, mais de tout un système alternatif. Parce que si les tomates que vous produisez ne parviennent pas équitablement au consommateur final, alors vous avez un problème. Si les hashtags et les campagnes ne finissent pas par rapporter de l'argent à une cause particulière et que cette cause n'est pas durable, alors personne n'est aidé. Vous devez provoquer un changement au sein du système en occupant les canaux de distribution. Il ne s'agit plus seulement d'occuper des images, mais aussi des terrains, des canaux de distribution, des postes de décision politique.
"L'interrogatoire" avec l'écrivain Édouard Louis © michiel devijver
BB : Quel rôle a l’art dans ce circuit ?
MR : Il faut comprendre chaque projet comme une microéconomie. Il y a les grands efforts collectifs comme le nouveau système de distribution de "The New Gospel" ou le fait que les tomates NoCap promues par le projet arrivent dans les supermarchés de toute l'Europe. Mais les petits projets sont également importants : les campagnes de collecte de fonds visant à acheter des terrains pour la production de biens alternatifs. Chaque petit geste compte : Quand je fais un entretien, comme celui-ci, je le lie avec un don pour la campagne "Nocap", qui œuvre pour l'intégration des réfugiés dans le sud de l'Italie. Nous pouvons donc en sortir peut-être un par jour, dix par semaine, mille par an, de la dépendance et de l'esclavage, et tout cela par les moyens de l'art, car ce sont les seuls moyens que je connaisse et que je puisse utiliser.
Bien sûr, il est également important de choisir un Jésus ou un apôtre noir, féminin ou musulman, comme nous l'avons fait dans le film. Mais il faut quand même se poser la question : À qui revient l'argent lorsque les gens vont au cinéma ? Que deviennent ces personnes par la suite ? Comment changer fondamentalement leurs conditions de vie ? Vous devez changer la façon dont le cinéma, la littérature, la conversation, la façon dont tout cela est produit. Nous devons penser et agir de manière fondamentalement et structurellement solidaire. Il ne s’agit plus de créer des bulles parfaites ou le festival d’art idéale avec la brochure de programme idéale. Il faut plutôt changer le monde, précisement pour ces personnes qui, pendant des siècles, n’ont été que les objets de ces discourses artistiques. C'est ce que je veux dire quand je dis que la culture et le capital doivent être liés.
BB : N'est-il pas également important pour l'art de maintenir une certaine distance ?
MR : La distance est une affirmation en soi dans un monde où tout est lié jusqu'au moindre détail, dans une économie où il n'y a pas d'extérieur. Le soi-disant "extérieur", la "distance" est un autre mot pour désigner le privilège. Franchement, je ne pense pas qu'il existe un acte humain apolitique. Si vous jouez une pièce de Tchekhov ou une simphonie de Beethoven en Allemagne en 1944, vous êtes apolitique dans le sens que vous créez un espace d'art pur au sein du meurtre millionnaire et que vous soutenez ainsi le régime fasciste. Chaque jour, nous créons notre système économique par les actions de chacun d'entre nous, en le faisant fonctionner, mais aussi en le modifiant. Chaque jour, nous créons notre système économique par les actions de chacun d'entre nous, en le faisant fonctionner, mais aussi en le modifiant.
Milo Rau pendant le travail sur la production "The new gospel" © NTGent
BB : Dans de nombreux pays d'Europe comme la Pologne ou la Hongrie, on voit actuellement une restriction des droits, souvent justifiée ou accélérée par la pandémie. Nous voyons des restrictions à la liberté de la presse, à la liberté de réunion et aux droits de l'homme. Quel rôle l'art peut-il jouer dans le mouvement de résistance en Europe ?
MR : Ce qui m'a toujours beaucoup aidé, c'est la solidarité, le fait de montrer que l'on n'est pas seul. Le pouvoir étatique fonctionne toujours avec des essentialismes, les gens sont racialisés, essentialisés selon leur origine, leur genre, leur religion, isolés. De sorte qu'ils ont l'impression d'être montrés du doigt précisément à cause de cette qualité, la couleur de leur peau, par exemple - et ils cherchent la faute en eux-mêmes. L'Holocauste et les processus de désolidarisation de la société en général ont fonctionné parce que les gens ne se sentaient plus concernés par ce qui arrivait aux autres. Les campagnes de haine fonctionnent toujours par le biais de la stigmatisation et, au final, tout le monde pense que les opprimés, les marginaux sont essentiellement responsables de ce qui leur arrive - ou du moins, ils restent silencieux lorsque quelqu'un est piégé.
BB : Quel rôle l'art joue-t-il dans la prévention de ces tactiques ?
MR : L'art peut créer la solidarité et l'identification par la politique de l'image. Qu'à l'aide de concepts généraux, d'images et d'histoires, par exemple par l'histoire de Jésus, on réalise soudain qu'il s'agit d'une histoire entièrement humaine qui se déroule aujourd'hui et qui nous concerne tous. Et vous ne pensez pas que ce qui se passe en Pologne se passe en Pologne, ce qui s'est passé dans les années 40 ne s'est passé que là. Le temps et l'espace n'existent pas en tant que topographie artistique. L'art peut être contre-historique, l'art peut entrer en contact avec les morts, l'art peut parler de ce qui n'est pas encore arrivé. L'art peut être une utopie, et l'art peut en même temps laisser cette utopie prendre place dans la réalité absolue, émotionnelle et collective d'un projet de théâtre et d'une soirée de cinéma. L'art peut avoir un effet direct et, en même temps, il est absolument fictif. Réunir la réalité et l'utopie, la pratique et l'espoir, voilà ce qu'est l'art.
BB : Voyez-vous un danger dans le fait qu'à une époque comme aujourd'hui, où l'art ne se produit pas de la même manière, où les scènes sont toutes fermées, où les gens ne peuvent pas sortir dans la rue et se rassembler, il devient plus facile pour les dictateurs et les autocrates d'influencer les systèmes ?
MR : Oui, dans les crises les droits sont toujours remis en cause. Les crises sont régressives, le plus conservateur, le plus destructeur est mis en jeu contre la destruction vécue. Les crises et les guerres déshumanisent la façon dont les gens se traitent les uns les autres. Le problème est surtout que l'art est retiré du contexte de la vie. Assister à une répétition, à une pièce de théâtre, être ensemble après et en parler, c’est ça, le vrai processus, qui m'intéresse. Ce n'est pas une séance où l'on va avec le masque sur le visage où l’on consomme quelque chose de créatif sans trop se rapprocher les uns des autres. La séparation de la vie et de l'art est l'une des nombreuses stratégies capitalistes d'aliénation qui existent depuis des siècles, elle n'a donc rien d'exceptionnel, mais en ce moment, nous la voyons dans sa forme la plus pure, pour ainsi dire : vous achetez un billet, entrez dans un online chat room et regardez d'autres personnes qui vivent ailleurs. Comme je l'ai dit, c'est le capitalisme dans sa forme la plus pure : l'art devient un bien de consommation, le corps de l'autre devient l'objet d'une observation distante. Or, le théâtre consiste précisément à faire entrer les corps dans un contexte de pratique vivante et utopique. C'est ce qui a été brutalement perdu au cours des 13 derniers mois. On ne grandit et ne change que par rapport aux autres et avec eux.
BB : Faites-vous actuellement l'expérience d'une plus grande solidarité au-delà des frontières nationales ?
MR : Oui et non. Au début, il y avait une forte tendance à la nationalisation, et aujourd'hui encore, il y a une fragmentation fédérale extrême, même en Allemagne. Il y a eu une désolidarisation, pas nécessairement consciente, mais simplement parce que les structures de solidarité à long terme - telles que les allocations de chômage, l'assurance maladie, sont nationales. C'est un problème général, qui se manifeste également dans la lutte contre le changement climatique ou dans l'industrie des biens.
Les coûts à long terme sont aussi désormais externalisés dans le Sud. Les personnes situées au début de la chaîne de production ne peuvent pas soudainement arrêter de produire du coton ou du coltan pendant quelques mois simplement parce que les T-shirts ou les ordinateurs ne sont pas nécessaires. Ils n'ont pas d'industrie de transformation et ne peuvent rien faire de ces matières premières si on ne les leur prend pas. Du côté positif, cependant, nous avons également remarqué à quel point ces États-nations étaient puissants, du moins au début, et quelles exigences extrêmes un État-nation peut imposer à ses citoyens et aussi à son économie. Cela peut sembler un peu étrange, mais cette discipline rationnelle des citoyens, qui pensent dans des contextes plus larges et font également preuve de solidarité, me rassure à l'ère du changement climatique, où seule l'action collective peut apporter quelque chose.
“Le tribunal sur le Congo”, 2017 © IIPM, Freuitmarket, Langfilm
BB : Et voyez-vous cela dans les arts et la culture également ?
MR : Le problème dans l'art est que beaucoup de personnes subtiles, intelligentes, mais aussi narcissiques se réunissent, avec une forte tendance à la dissidence minimale. Je suis ici pour un entretien individuel, mais j'organise un panel de dix artistes et je les laisse discuter des sujets mêmes que nous venons d'aborder ici : la solidarité mondiale, le changement du monde. Là, au bout de dix minutes, c'en est fini de la solidarité, de l'écoute, au bout de dix minutes l'essentialisme commence : qui parle, pourquoi, avec quels mots. Il y a une envie d'avoir raison et de s'attarder sur certaines formulations qui sont correctes ou non. Quiconque a déjà rédigé une lettre ouverte avec cinq ONG sait combien il faut de temps pour se mettre d'accord sur les détails afin.
C'est le problème de l'industrie culturelle : nous traitons de questions universelles - de la mémoire, de la tradition et des utopies possibles - mais en même temps, c'est un club de petits esprits et de narcissiques. C'est ce qui nous rend malades. Nous n'avons pas la "coolitude" des scientifiques et des chercheurs qui acceptent une bactérie comme un fait et ne veulent pas l'interpréter. Il est difficile d'établir une solidarité qui ne soit pas négative, par exemple lorsqu'on ne s'oppose pas à quelque chose par une lettre ouverte, mais qui soit positive. Je souffre beaucoup de cette agressivité souvent malheureusement complètement destructrice. Et c'est pourquoi le travail solidaire est en fait la seule chose qui m'intéresse encore.
BB : Et la scène artistique n’a rien appris depuis l'année dernière ?
MR : Je ne dirais pas ça, parce qu’il y a eu des bonnes initiatives. Il y a aussi eu des pressions sur l'Etat. Les artistes sont très bons pour cela, parce qu'ils sont écoutés, parce qu'ils sont des experts de l'utilisation de l'opinion publique et des médias. Je pense que, structurellement, il existe déjà une solidarité dans les arts. Il y a fondamentalement une volonté de se soucier davantage de certains aspects sociaux dans cette niche que dans d'autres professions, où vous n'avez pas le luxe de faire des détours.
BB : Pensez-vous que la conscience de l'importance de la culture a augmenté grâce à la pandémie ?
MR : Je n'ai pas beaucoup pensé à ça, j'ai une conception trop holistique de la culture. Pendant le confinement, je dansais à la maison avec mes filles, nous lisions des livres, nous regardions des pièces de théâtre. Nous avons fait d'autres choses dans nos vies que nous n'avions pas faites auparavant. L'espace privé est soudainement redevenu très riche. Beaucoup de choses qui avaient été externalisées ont en quelque sorte été remises en mémoire. C'est bon et mauvais en même temps. Je pense que si vous n'avez pas de famille ou d'amis proches, il y a beaucoup de solitude pendant Covid. Aller au cinéma, par exemple, qui n'est plus possible, est dans ce cas-là, perçu comme une immense perte. Pour ma part, j’ai surtout perçu très clairement le découpage des différents processus, entre la consommation, la vie privée, la sphère publique, la virtualité. Si ces liens sont si faibles, si instables, et peuvent être si facilement défaits par cette petite peste, alors nous devons maintenant travailler sur des alternatives qui valent vraiment la peine d'être vécues.
BB: Merci beaucoup, Milo Rau.
Interview: Thorsten Schröder
Biographie:
Milo Rau et son travail sont difficile à catégoriser. Le dramaturge suisse a publié plus de 50 pièces, films et livres, a été invité à deux reprises au « Theatertreffen » de Berlin et a reçu des doctorats honorifiques des universités de Lund et de Gand. À seulement 41 ans, Milo Rau a reçu le prix du théâtre européen pour l'ensemble de son œuvre. Il est directeur artistique de NTGent depuis la saison 2018/19. Son nouveau film "The New Gospel" pose la question suivante : que dirait Jésus de la crise des réfugiés d'aujourd'hui ? Dans la série de discussions en direct "School of Resistance", il discute de l'art en tant que pratique transformatrice et créatrice de réalité avec des militants et des artistes. Avec Béton Bleu, il a parlé sur le rôle de l'art comme moyen de résistance ainsi que la façon dont il changera après la pandémie.
Trouvez plus d’informations ici.
(C) 09/05/2021
FIND more curated content on instagram: @bétonbleumagazine